La « bioremédiation » consiste à dépolluer l’environnement en utilisant les compétences des plantes. Cette technique récente est de plus en plus utilisée. Pour le meilleur et pour le pire.

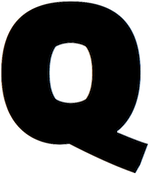 uand un être humain se retrouve dans un environnement qui devient soudain malsain, il a – en principe – la capacité de bouger afin d’aller dans un endroit plus agréable. C’est bien pratique et de nombreux organismes, les plantes ou les champignons par exemple, peuvent nous envier cette chance : eux ne peuvent pas se déplacer ! Mais ils ont mis en place d’autres stratégies : celles-ci consistent non pas à s’éloigner de la source de nuisance, mais à la contrôler.
uand un être humain se retrouve dans un environnement qui devient soudain malsain, il a – en principe – la capacité de bouger afin d’aller dans un endroit plus agréable. C’est bien pratique et de nombreux organismes, les plantes ou les champignons par exemple, peuvent nous envier cette chance : eux ne peuvent pas se déplacer ! Mais ils ont mis en place d’autres stratégies : celles-ci consistent non pas à s’éloigner de la source de nuisance, mais à la contrôler.
C’est ainsi que des associations d’organismes peuvent en quelques temps transformer un milieu invivable en milieu tout à fait tolérable pour eux. Ces propriétés sont étudiées depuis des dizaines d’années et sont même aujourd’hui « technologisées », afin d’utiliser les associations du vivant pour dépolluer les sols. C’est de ce principe et de son utilisation technologique dont je vais vous parler aujourd’hui. Les plantes sont également employées pour purifier les eaux ou l’air intérieur, sujets sur lesquels je me pencherai dans de prochains articles.
Bioremédiation, phytoremédiation, phytoépuration…
La phytoremédiation, du grec ancien φυτόν (phytos), « végétal », désigne les technologies de dépollution qui utilisent des plantes vasculaires : celles qui ont des racines et des vaisseaux pour conduire la sève. Mais comme il n’y a pas que les plantes vasculaires dans le règne végétal – il y a aussi les algues et les champignons – nous parlerons plutôt de bioremédiation, du grec ancien βίος (bios), la « vie », pour désigner les techniques de dépollution par des écosystèmes. Selon la technologie employée et la destination du polluant, on parlera de bio-épuration, de bio-stabilisation, de bio-extraction, de bio-filtration, etc.
La biorémédiation en théorie
Dans la nature, les plantes poussent en échangeant des composés nutritifs avec les micro-organismes du sol. Par exemple, des bactéries présentes dans la terre dégradent certains composés en minéraux, absorbables par les racines, et en échange se nourrissent des substances qui s’écoulent le long des racines. Ces exsudats racinaires sont constitués de déchets (cellules mortes, etc., eh oui les plantes aussi défèquent !), et de composés qui permettent de modifier l’environnement direct autour des racines, afin qu’elles se développent dans les meilleures conditions (nous, si on a froid, on met un pull, une plante vasculaire, si elle se sent mal, sécrète un petit mucus autour de ses racines).
Et si par malheur des composés toxiques s’accumulent dans l’environnement, les bactéries et les plantes vont s’employer à les gérer. Bien souvent, les bactéries savent dégrader les polluants organiques, tandis que les plantes, elles, peuvent accumuler parfois dans leurs cellules les polluants, en les stockant à part pour ne pas qu’ils interagissent avec le reste de leur métabolisme. Le système complet inclut les bactéries, les champignons, les plantes.
La bioremédiation en pratique
Cependant, comme je l’avais expliqué dans un précédent article, cette technique ne peut permettre de « dépolluer » un sol que s’il est faiblement contaminé, uniquement en surface (ou du moins jusqu’où peuvent plonger les racines), et nécessite beaucoup de temps. Citons par exemple les cultures d’alysson des murs (une plante de la famille du colza) en Albanie dans des champs contaminés au nickel (voir à ce sujet l’article de nos confrères de Reporterre). L’alysson est capable de stocker ce métal toxique dans son corps : elle l’absorbe et le range dans un petit compartiment spécial de ses cellules. Cette accumulation peut constituer jusqu’à 2 % de son poids, ce qui représente une énorme part de son propre organisme sacrifié pour conserver hors de portée du reste du métabolisme le composé toxique.
Les chercheurs sont actuellement en train d’étudier la possibilité de récupérer ce nickel stocké par les plantes en les incinérant. Aujourd’hui, le coût financier d’une telle opération est supérieur à celui de l’extraction du nickel du sol en creusant des mines traditionnelles mais semble bien moins polluant. Cependant, il faut attendre parfois des décennies avant de pouvoir s’assurer de la dépollution du sol, ce n’est donc pas la panacée.
Le temps nécessaire aux plantes pour réduire la quantité de métaux lourds dans les terres contaminées dépend de deux facteurs : la quantité de biomasse qu’elles produisent (à quelle vitesse poussent-elles, font-elles beaucoup de feuilles ?) et leur capacité à concentrer des métaux. Ce taux de « bioconcentration » est déterminé par leur aptitude à absorber les métaux transportés par la sève et à les stocker dans les tissus en maintenant un métabolisme correct (une plante qui accumule un composé toxique et en meurt n’est pas « efficace »). Or, à l’exception de celles dites « hyperaccumulatrices », les plantes ont des facteurs de bioconcentration métallique faibles.

Il faut plus de temps qu’une vie humaine pour réduire ne serait-ce que de moitié la contamination d’un sol. Pour parvenir à une réduction significative des contaminants en une ou deux décennies, il est donc nécessaire d’utiliser des plantes qui poussent beaucoup ou qui stockent beaucoup. Et la tentation est grande, chez certains, d’essayer d’obtenir artificiellement des taux record de production de biomasse ou de bioconcentration.
Des plantes perfectionnées industriellement
Pour les industriels, une plante idéale pour la dépollution doit donc à la fois pousser rapidement, accumuler beaucoup du polluant visé, résister à une forte concentration dudit polluant, et développer un fort système racinaire, garant de l’étendue et de la profondeur de la zone travaillant à la dépollution. Le mode de « traitement » du polluant doit également être pris en compte selon que l’on souhaite le voir s’accumuler dans les parties aériennes, dans les racines ou bien de le voir se transformer en d’autres composés et s’évacuer dans l’atmosphère, etc.
De ce cahier des charges à la bioingéniérie, il n’y a qu’un pas : les projets visant à améliorer les propriétés bioaccumulatrices des plantes sont nombreux. Il est par exemple possible d’ajouter dans le sol des micro-organismes stimulants qui, soit permettront aux racines d’être encore plus efficaces dans leur absorption, soit rendront le composé toxique plus facile à assimiler (1). On peut rêver aussi de faire produire à une plante à croissance rapide et racines profondes les composés accumulateurs de certaines bactéries, pour combiner les caractéristiques les plus efficaces de ces deux règnes.
Alors, tout est réglé ?
On l’a vu, les plantes ont, avec leur système racinaire, des propriétés remarquables qui leur permettent de survivre même dans les milieux contaminés. Vouloir utiliser ces propriétés dans un dessein écologique semble une bonne initiative : si les plantes peuvent absorber les polluants, pourquoi ne pas les planter dans les terrains contaminés ? Cependant, il ne faut pas oublier le temps long du vivant. De plus, que faire des plantes contaminées ? Toutes ne peuvent pas permettre un « biominage » (récupérer d’un métal via une plante et non en allant miner le sol), certains composés ne pouvant pas être récupérés, d’autres risquant de se répandre de nouveau dans l’environnement une fois les plantes mortes. Enfin, vouloir tout résoudre par l’ingéniérie c’est s’autoriser à transformer le vivant pour le soumettre à nos besoins.
Si par super-pouvoir on entend compétence que les humains n’ont pas et qui leur serait utile, alors oui, les plantes en ont plein : régénération, clonage, autotrophie, dépollution… la liste est immense. Mais si cela signifie en fait essayer de les utiliser pour résoudre nos problèmes, les résultats seront plus mitigés. Et si, au lieu de chercher la technologie magique qui remettra tout comme avant, on arrêtait tout simplement de détruire notre environnement ?
(1) Pour accumuler un polluant, les plantes sécrètent des composés qui s’y agrippent et l’empêchent de migrer dans d’autres parties de la plante. Une fois les enzymes qui permettent de produire ces composés identifiées, il est envisageable d’en augmenter la production en stimulant artificiellement les bons gènes.
Sources :
• « Des plantes pour dépolluer ou stabiliser des éléments toxiques dans les sols et les eaux » par Alain Vavasseur, Pierre Richaud et Julie Misson-Pons dans la revue Biofutur nº 295, janvier 2009.
• « Molecular biology, requirements for application, environmental protection, public attention and feasibility » par Andreas D. Peuke et Heinz Rennenberg in European Molecular Biology Organization nº 6, p. 497-501, juin 2005.









