De la société de consommation à… la société de consumation ?

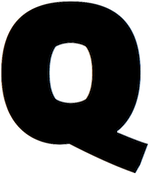 uand j’étais enfant, je voulais devenir « pompiette ». Sans doute parce qu’un pompier avait perdu la vie en voulant sauver la mienne et celle des dizaines de vacanciers prisonniers d’un incendie fulgurant autour du lac de Saint-Cassien (Var). Finalement je suis devenue journaliste, là aussi pour le côté Zorro du métier, mais, ironie du sort, durant les années où j’ai travaillé à Charlie Hebdo, mes collègues et moi avons été itérativement accusés de « mettre de l’huile sur le feu » (il est vrai que les mots peuvent brûler – ou apaiser).
uand j’étais enfant, je voulais devenir « pompiette ». Sans doute parce qu’un pompier avait perdu la vie en voulant sauver la mienne et celle des dizaines de vacanciers prisonniers d’un incendie fulgurant autour du lac de Saint-Cassien (Var). Finalement je suis devenue journaliste, là aussi pour le côté Zorro du métier, mais, ironie du sort, durant les années où j’ai travaillé à Charlie Hebdo, mes collègues et moi avons été itérativement accusés de « mettre de l’huile sur le feu » (il est vrai que les mots peuvent brûler – ou apaiser).
Aujourd’hui, en tout cas, ni les lances des pompiers ni les articles des journalistes ne semblent en mesure d’arrêter l’incinération de la biodiversité provoquée par notre civilisation prédatrice. D’un continent à l’autre, au fil des saisons, nous assistons en direct à des bûchers géants d’animaux et de plantes sauvages dont il ne restera bientôt plus que des silhouettes carbonisées sur Internet.
BURNOUT GÉNÉRALISÉ
Et pendant qu’en Australie, en Sibérie, en Zambie ou en Amazonie, les derniers bouts du jardin d’Éden partent en fumée, nous assistons dans nos pays capitalistes à un autre genre de combustion : celle qui dévaste les humains de l’intérieur lors des phénomènes d’épuisement professionnel. Dans les années 1970, le psychanalyste américain Herbert J. Freudenberger l’appela le burnout : « En tant que praticien, je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d’incendie, tout comme les immeubles. Sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe leurs ressources internes en viennent à se consumer comme sous l’action des flammes, ne laissant qu’un vide immense à l’intérieur, même si l’enveloppe externe semble plus ou moins intacte. »
Le mouvement social actuel contre l’extension de la durée de vie au travail, qui constitue l’une des plus longues grèves de l’Histoire de France, n’est-il pas, d’abord, la manifestation d’une farouche volonté de sauver sa peau ?








