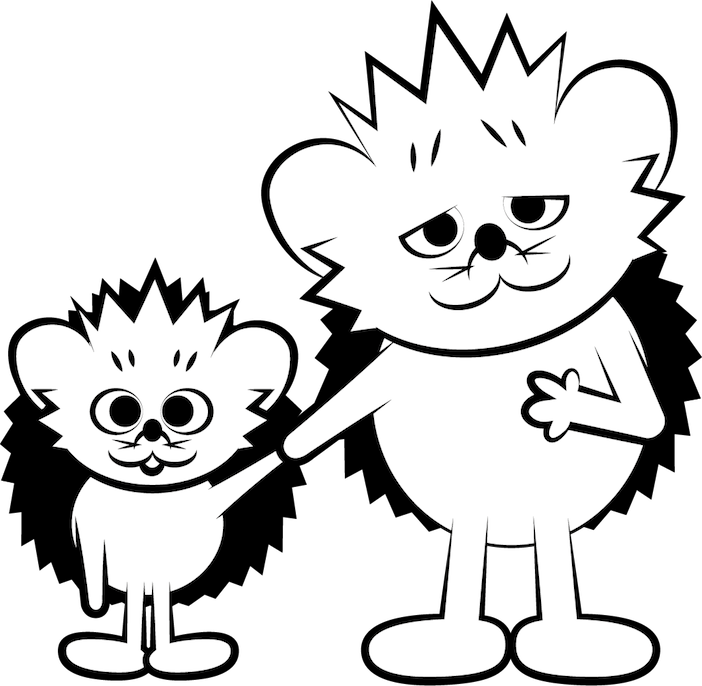C’est un petit jardin parisien extraordinaire, comme il n’en existe plus, un jardin tout droit sorti des Misérables. Causette et Jean Valjean y ont trouvé refuge, l’occasion pour Victor Hugo de livrer sa perception cosmique de la nature. Extrait.

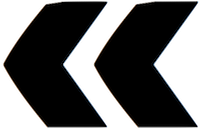 Ce jardin ainsi livré à lui-même depuis plus d’un demi-siècle était devenu extraordinaire et charmant. Les passants s’arrêtaient dans cette rue pour le contempler, sans se douter des secrets qu’il dérobait derrière ses épaisseurs fraîches et vertes. Plus d’un songeur à cette époque a laissé bien des fois ses yeux et sa pensée pénétrer indiscrètement à travers les barreaux de l’antique grille cadenassée, tordue, branlante, scellée à deux piliers verdis et moussus, bizarrement couronnée d’un fronton d’arabesques indéchiffrables.
Ce jardin ainsi livré à lui-même depuis plus d’un demi-siècle était devenu extraordinaire et charmant. Les passants s’arrêtaient dans cette rue pour le contempler, sans se douter des secrets qu’il dérobait derrière ses épaisseurs fraîches et vertes. Plus d’un songeur à cette époque a laissé bien des fois ses yeux et sa pensée pénétrer indiscrètement à travers les barreaux de l’antique grille cadenassée, tordue, branlante, scellée à deux piliers verdis et moussus, bizarrement couronnée d’un fronton d’arabesques indéchiffrables.
Il y avait un banc de pierre dans un coin, une ou deux statues moisies, quelques treillages décloués par le temps pourrissant sur le mur ; du reste plus d’allées ni de gazon ; du chiendent partout. Le jardinage était parti, et la nature était revenue. Les mauvaises herbes abondaient, aventure admirable pour un pauvre coin de terre. La fête des giroflées y était splendide. Rien dans ce jardin ne contrariait l’effort sacré des choses vers la vie ; la croissance vénérable était là chez elle. Les arbres s’étaient baissés vers les ronces, les ronces étaient montées vers les arbres, la plante avait grimpé, la branche avait fléchi, ce qui rampe sur la terre avait été trouver ce qui s’épanouit dans l’air, ce qui flotte au vent s’était penché vers ce qui se traîne dans la mousse ; troncs, rameaux, feuilles, fibres, touffes, vrilles, sarments, épines, s’étaient mêlés, traversés, mariés, confondus ; la végétation, dans un embrassement étroit et profond, avait célébré et accompli là, sous l’œil satisfait du créateur, en cet enclos de trois-cents pieds carrés, le saint mystère de sa fraternité, symbole de la fraternité humaine. Ce jardin n’était plus un jardin, c’était une broussaille colossale, c’est à dire quelque chose qui est impénétrable comme une forêt, peuplé comme une ville, frissonnant comme un nid, sombre comme une cathédrale, odorant comme un bouquet, solitaire comme une tombe, vivant comme une foule.
En floréal, cet énorme buisson, libre derrière sa grille et dans ses quatre murs, entrait en rut dans le sourd travail de la germination universelle, tressaillait au soleil levant presque comme une bête qui aspire les effluves de l’amour cosmique et qui sent la sève d’avril monter et bouillonner dans ses veines, et, secouant au vent sa prodigieuse chevelure verte, semait sur la terre humide, sur les statues frustes, sur le perron croulant du pavillon et jusque sur le pavé de la rue déserte, les fleurs en étoiles, la rosée en perles, la fécondité, la beauté, la vie, la joie, les parfums. A midi mille papillons blancs s’y réfugiaient, et c’était un spectacle divin de voir là tourbillonner en flocons dans l’ombre cette neige vivante de l’été. Là, dans ces gaies ténèbres de la verdure, une foule de voix innocentes parlaient doucement à l’âme, et ce que les gazouillements avaient oublié de dire, les bourdonnements le complétaient. Le soir une vapeur de rêverie se dégageait du jardin et l’enveloppait ; un linceul de brume, une tristesse céleste et calme, le couvraient ; l’odeur si enivrante des chèvrefeuilles et des liserons en sortait de toute part comme un poison exquis et subtil ; on entendait les derniers appels des grimpereaux et des bergeronnettes s’assoupissant sous les branchages ; on y sentait cette intimité sacrée de l’oiseau et de l’arbre ; le jour les ailes réjouissent les feuilles, la nuit les feuilles protègent les ailes.
L’hiver, la broussaille était noire, mouillée, hérissée, grelottante, et laissait un peu voir la maison. On apercevait, au lieu de fleurs dans les rameaux et de rosée dans les fleurs, les longs rubans d’argent des limaces sur le froid et épais tapis de feuilles jaunes ; mais de toute façon, sous tout aspect, en toute saison, printemps, hiver, été, automne, ce petit enclos respirait la mélancolie, la contemplation, la solitude, la liberté, l’absence de l’homme, la présence de Dieu ; et la vieille grille rouillée avait l’air de dire : ce jardin est à moi.
Le pavé de Paris avait beau être là tout autour, les hôtels classiques et splendides de la rue de Varenne à deux pas, le dôme des Invalides tout près, la Chambre des députés pas loin ; les carrosses de la rue de Bourgogne et de la rue Saint-Dominique avaient beau rouler fastueusement dans le voisinage, les omnibus jaunes, bruns, blancs, rouges, avaient beau se croiser dans le carrefour prochain, le désert était rue Plumet ; et la mort des anciens propriétaires, une révolution qui avait passé, l’écroulement des antiques fortunes, l’absence, l’oubli, quarante ans d’abandon et de viduité, avaient suffi pour ramener dans ce lieu privilégié les fougères, les bouillons-blancs, les cigües, les achillées, les digitales, les hautes herbes, les grandes plantes gaufrées aux larges feuilles de drap vert pâle, les lézards, les scarabées, les insectes inquiets et rapides ; pour faire sortir des profondeurs de la terre et reparaître entre ces quatre murs je ne sais quelle grandeur sauvage et farouche ; et pour que la nature, qui déconcerte les arrangements mesquins de l’homme et qui se répand toujours tout entière là où elle se répand, aussi bien dans la fourmi que dans l’aigle, en vînt à s’épanouir dans un méchant petit jardin parisien avec autant de rudesse et de majesté que dans une forêt vierge du Nouveau Monde.
Rien n’est petit en effet ; quiconque est sujet aux pénétrations profondes de la nature, le sait. Bien qu’aucune satisfaction absolue ne soit donnée à la philosophie, pas plus de circonscrire la cause que de limiter l’effet, le contemplateur tombe dans des extases sans fond à cause de toutes ces décompositions de forces aboutissant à l’unité. Tout travaille à tout.
L’algèbre s’applique aux nuages ; l’irradiation de l’astre profite à la rose ; aucun penseur n’oserait dire que le parfum de l’aubépine est inutile aux constellations. Qui donc peut calculer le trajet d’une molécule ? que savons-nous si des créations de mondes ne sont point déterminées par des chutes de grains de sable ? qui donc connaît les flux et les reflux réciproques de l’infiniment grand et de l’infiniment petit, le retentissement des causes dans les précipices de l’être, et les avalanches de la création ? Un ciron importe ; le petit est grand, le grand est petit ; tout est en équilibre dans la nécessité ; effrayante vision pour l’esprit. Il y a entre les êtres et les choses des relations de prodige ; dans cet inépuisable ensemble, de soleil à puceron, on ne se méprise pas ; on a besoin les uns des autres. »
Victor HUGO
extrait, Les Misérables, 1862
REJOIGNEZ NOS DONATEURS !
Le journal minimal est un site d’information indépendant et à but non lucratif, pour tous les citoyens qui ne croient plus dans la société de consommation. Il fonctionne comme une ONG, avec des donateurs mensuels.
Vous aussi, soutenez le projet et aidez-nous à produire de nouveaux contenus inédits et en accès libre ! 🤑
Faire un don au journal minimal c’est participer, article après article, à la déconstruction du capitalisme. Chaque euro compte énormément, vous pouvez choisir le montant que vous souhaitez et obtenir une défiscalisation à 66 % :
Merci pour votre soutien !