Alors que les prix de l’immobilier flambent dans la capitale, des artistes se sont emparés d’un immeuble inoccupé rue Blanche (Paris 9e). Récit de cette aventure homérique, baptisée « Nos nuits au Post ».

Le feuilleton Squat story est raconté ici par Gaspard Delanoë, figure historique des squats parisiens, ouvreur du célèbre 59 Rivoli, conventionné avec la Ville de Paris. Né début janvier 2019, Le Post connaitra-t-il un sort similaire ? Une convention d’occupation provisoire est en cours d’examen.
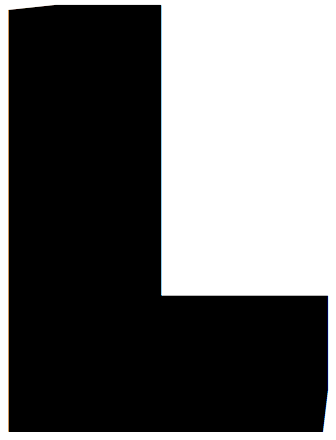 e samedi 5 janvier 2019, vers 17 h, Alexandre Gain, un activiste bien connu dans le milieu des squats d’artistes parisiens envoya ce post sur Facebook :
e samedi 5 janvier 2019, vers 17 h, Alexandre Gain, un activiste bien connu dans le milieu des squats d’artistes parisiens envoya ce post sur Facebook :
« Vous avez toujours rêvé d’ouvrir un squat ? Vous avez envie de faire quelque chose de bien en ce début d’année ? Vous rêvez de l’aventure mais vous n’êtes même pas capables de trouver la rue Marx Dormoy sur un plan de Paris ? Rendez-vous demain à 17 h au 73 rue Philippe de Girard, venez avec doudoune, sac de couchage et thermos, c’est parti !! »
Dehors, un froid glacial tétanisait les rues et le ciel, indécis, hésitait entre la souffrance et l’ennui. Des centaines d’internautes likèrent et commentèrent les mots d’Alexandre Gain dans les heures qui suivirent la publication de son post. Certains s’en amusèrent. D’autres n’y crurent pas une seule seconde, persuadés qu’il s’agissait là d’une tentative de diversion. D’autres encore se dirent : chiche ! La plupart, en vérité, pensèrent qu’il ne fallait guère prendre au sérieux cette énième pirouette d’Alexandre Gain car ils étaient habitués aux délires intempestifs de ce grand échalas – 1,92 m – généralement habillé d’un legging gris et de chaussettes rouges montant jusqu’à mi-mollet.
Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux — Guy Debord
Il est difficile de savoir jusqu’à quel point Alexandre Gain compta sur l’atmosphère de fake news qui régnait dans le pays pour publier son post. Et d’une certaine manière la multiplication d’informations loufoques, de sites complotistes et autres pseudo médias en ligne qui pullulaient sur la Toile facilitèrent son bluff. Ce qui était certain en tout cas, c’est qu’en publiant un tel post, Alexandre Gain commettait une double transgression.
D’une part il brisait le tabou absolu de la publicité d’un tel acte : tous les squatteurs le savent, la première règle à suivre pour réussir à ouvrir un squat est d’être d’une grande discrétion, de ne surtout pas se faire remarquer lors du repérage, et a fortiori lors de l’ouverture du lieu et des premiers jours passés à l’intérieur, généralement désignés sous le nom évocateur de « sous-marin ».
Mais il brisait également un deuxième tabou, tout aussi décisif : en appelant potentiellement n’importe qui à se joindre à l’ouverture, Gain faisait exactement le contraire de ce que font habituellement les squatteurs : constituer une petite équipe soudée, rassemblée, de gens qui se connaissent bien et qui se font mutuellement confiance. De fait, les flics n’auraient-ils pas beau jeu d’envoyer un indic lors du rendez-vous à 17 h, pour pouvoir les cueillir en flagrant délit d’effraction et les coffrer tranquillement ?
Pourtant, vers 17 h, le lendemain, lorsqu’une trentaine de jeunes gens se présentèrent au 73 rue Philippe de Girard, l’ambiance était guillerette. Un certain nombre de personnes se connaissaient déjà (une quinzaine) auxquels s’ajoutaient cinq ou six activistes venant d’autres squats plus quelques badauds inconnus, venus s’encanailler ou prêts à tout pour vivre des sensations fortes.
Y avait-il un flic parmi eux ? C’était impossible à dire, mais la tactique utilisée par Gain et ses troupes fut la suivante : ils se séparèrent en cinq groupes de cinq ou six personnes, sachant qu’une seule personne par groupe connaissait la destination finale de la « promenade ». Puis chaque groupe partit, chacun empruntant un itinéraire différent pour arriver au but.
L’objectif était double : d’une part, il s’agissait tout d’abord de ne pas constituer un groupe de trente personnes, avec des sacs de couchage dans le dos, en train de se « promener » un dimanche après-midi dans Paris. Cela aurait eu l’air louche. D’autre part, il s’agissait de démasquer l’éventuel flic qui s’était glissé dans le groupe et pour cela il était beaucoup plus facile de se retrouver dans des groupes de cinq six plutôt que dans un grand tas de trente.
Vous nous voyez cy attachés cinq, six/Quant de la chair, que trop avons nourrie/Elle est piéça* dévorée et pourrie — François Villon
Dans la guérilla que mènent les artistes-squatteurs à Paris depuis une quarantaine d’années, une bataille est considérée comme gagnée quand les squatteurs ne se font pas expulser avant d’être arrivés au procès. Autrement dit s’ils ne se font pas expulser dans les premiers jours de leur occupation.
Il existe en effet un flou juridique quant à l’expulsion immédiate des dits squatteurs. On entend généralement qu’il suffit d’excéder le délai de quarante-huit heures passées dans le squat pour éviter l’expulsion immédiatement par la police et avoir droit à un procès. Cependant, l’expérience montre que parfois il vaut mieux passer jusqu’à soixante-douze heures voire quatre-vingt-seize heures pour être sûrs de ne pas se faire expulser illico. On a même vu des cas où un collectif s’est fait expulser – illégalement sans doute – au bout de dix jours voire quinze jours d’occupation !
Bien entendu, la plupart du temps, après quelques mois d’occupation, un tribunal prononce un arrêté d’expulsion, et les squatteurs se font virer par les CRS du lieu qu’ils occupent. Et si cette expulsion est toujours vécue amèrement (car dans nombre de situations, le lieu reste vacant après leur expulsion pendant des mois et parfois même des années), elle n’est pas considérée comme une bataille perdue.
En effet, dans cette guérilla, il y a deux camps. Celui des défendeurs : les propriétaires, publics ou privés, d’immeubles vacants. Celui des attaquants : les squatteurs, dont le but est de prendre temporairement des lieux afin d’y construire des alternatives : artistiques, politiques, sociales, culturelles.
Une armée défensive n’est victorieuse que si elle l’emporte sur tous les lieux alors que celui qui attaque n’a besoin que de vaincre en un seul point pour annuler tous les autres succès de l’ennemi — Clausewitz
Une bataille est donc considérée comme gagnée lorsque les squatteurs obligent le propriétaire à démarrer une procédure, c’est-à-dire à se munir d’un avocat, à faire constater par huissier l’occupation illégale, à assigner en justice les squatteurs puis attendre le procès.
En effet, pendant les mois que dure la procédure – parfois deux mois, parfois six, parfois même un an –, les squatteurs peuvent médiatiser leur combat, prendre à partie la société toute entière et dénoncer publiquement combien il est scandaleux que des milliers de mètres carrés restent vacants dans la ville tandis que des milliers de précaires dorment dans la rue, ou dans des taudis, ou dans des villages si lointains qu’ils perdent un temps considérable dans les transports qui, d’une certaine manière, les marginalisent, les externalisent, les renvoie loin du centre.
Et le combat médiatique est un combat où les propriétaires, dans la plupart des cas, perdent des plumes. Car dans une société qui se révèle de plus en plus inégalitaire, l’opinion publique bascule le plus souvent du côté des squatteurs quand ceux-ci expliquent – dans des journaux ou dans des interviews – qu’il est préférable que des bâtiments soient occupés par des précaires pour y vivre ou pour y travailler plutôt que laissés vacants pendant des années.
Alexandre Gain et tous ceux qui avaient lu son post sur Facebook étaient donc en passe de gagner une nouvelle bataille…
> Retrouvez la suite du feuilleton vendredi 16 mai 2019 dans le journal minimal.
> À (re)lire : les autres épisodes de la série Squat story.
Vous aimez nos articles ? Aidez-nous à grandir !






